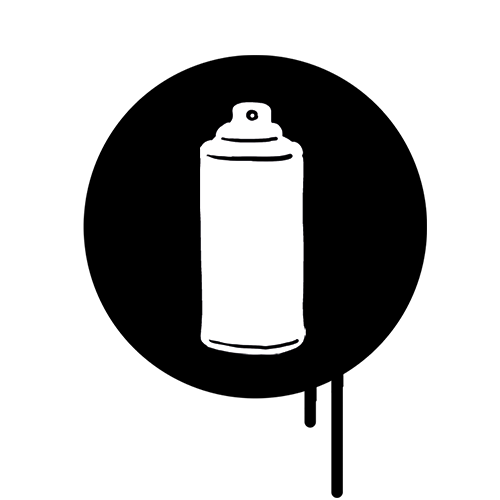Pourquoi les queers sont si agressifs entre eux ?
Cet article a été initialement écrit par Kai Chang Thom sur Dalyxtra le 16 août 2019.
Comment la neurologie explique les traumatismes, les conflits et la culture du call-out chez les queers.
« Confondre être mortel et être menacé peut se produire dans n’importe quel domaine. Le fait que quelque chose puisse mal tourner ne signifie pas que nous sommes en danger. Ça veut dire qu’on est en vie. » — Sarah Schulman, Conflict Is Not Abuse
Quand j’ai commencé à travailler comme thérapeute pour les jeunes personnes queer et trans, il se passait rarement une semaine sans qu’un-e de mes client-e-s n’apporte une nouvelle histoire de drame queer explosif : quelqu’un-e avait dit quelque chose de problématique dans un groupe social et était maintenant harcelé-e jusqu’au bout du monde pour lui demander de prendre ses responsabilités. Quelqu’un-e avait un conflit avec son colocataire, qui s’était transformé en une série de call-out sur les médias sociaux, qui s’était transformée en une guerre totale entre groupes d’ami-e-s. Tout le monde allumait tout le monde. Tout le monde était problématique. Personne ne se sentait en sécurité avec personne.
En tant que « sage thérapeute adulte » (de façon absurde, j’avais souvent à peine un an ou deux de plus que mes client-e-s) dans cette situation, c’était mon travail d’offrir une perspective compatissante sur l’ensemble de la situation. Il y a une liste de leçons de vie que les thérapeutes sont censées enseigner ici : à savoir, que le conflit se produit, mais que nous pouvons y survivre. Les gens sont souvent décevants et nous avons le droit de fixer des limites à nos relations – mais si nos limites sont trop rigides, alors nous serons toujours déçus. Le fait que quelqu’un puisse ne pas nous apprécier ou ne pas nous aimer ne signifie pas que nous sommes intrinsèquement indignes de l’être. C’est cette sagesse qui fait partie du voyage de l’adolescence à l’âge adulte, de la jeunesse à la maturité.
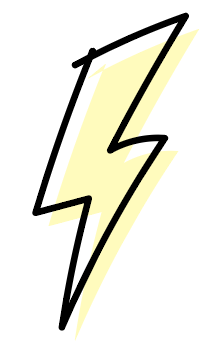
Sauf que j’ai souvent eu l’impression que les queers adultes de mon propre monde ne semblaient pas s’en sortir beaucoup mieux avec les conflits, la compassion et la construction des relations. En fait, à certains égards, j’ai l’impression que nous faisons pire, parce que les adultes ont souvent plus de pouvoir pour nuire directement à la vie d’une personne en situation de conflit. Au cours des dernières années, les médias sociaux ont semblé être une plaque tournante de dénonciations. L’évitement social, la propagation de rumeurs et l’inscription sur liste noire (« cancelling ») de personnes lors d’événements et d’espaces communautaires pour des infractions allant des déclarations politiquement problématiques à la violence physique sont courants. Et le gaslighting est le mot préféré de chacun, sauf lorsqu’il est appliqué à son propre comportement.
Tout ça pour dire que la communauté dans laquelle j’ai passé toute ma vie d’adulte à travailler et à vivre semble parfois encore plus dangereuse et explosive que le monde dominant, cis et hétéronormatif que j’ai passé mon adolescence à essayer de fuir. Après tout, je peux au moins imputer la cruauté de la société hétérosexuelle à l’homophobie et à la transphobie. Mais pourquoi les queers sont-ils si méchant-e-s avec les queers ?
C’est une question qui me hante depuis une dizaine d’années et qui me vient de plus en plus à l’esprit au fur et à mesure que j’essaie de grandir — de laisser derrière moi le drame et le traumatisme constants qui ont caractérisé mon adolescence. Comment se fait-il qu’une communauté construite autour de la notion d’amour libre, de sécurité et de choisir sa famille finisse si souvent par être cruelle et impitoyable envers ses propres membres ?
C’est une question qui devient particulièrement importante dans l’arène sociopolitique plus large alors que le fascisme et la crise climatique nous guettent, car si les communautés queers ne peuvent pas trouver un moyen de se rassembler dans l’unité et la solidarité, alors nous ne survivrons probablement pas. Et c’est une question que les penseuses queers et transgenres ont abordée sous différents angles ces dernières années, comme nous le voyons dans le livre Emergent Strategy (2017) de l’activiste de Detroit Adrienne Maree Brown et dans le célèbre Conflict is Not Abuse (2016) de Sarah Schulman, du New Yorker. Schulman aborde ce sujet du point de vue d’une activiste-universitaire, soulignant que la communauté queer est truffée de conflits qui sont à tort qualifiés d’abus, ce qui mène ensuite à une escalade croissante du conflit qui tend à se terminer par un rejet et un exil social.
Brown écrit cela en tant qu’organisatrice de communauté et visionnaire sociale, soulignant que l’organisation de mouvements pour la survie et le changement social ne peut être soutenue seulement par une culture de la critique et de la dénonciation. Je crois que les deux ont raison, mais ces points importants n’expliquent toujours pas pourquoi les communautés queers sont si enclines à ce genre de dynamique sociale autodestructrice. J’ai abandonné mon statut et ma pratique de thérapeute plus tôt cette année, mais je resterai toujours une nerd de la thérapie dans l’âme. Quand je me demande pourquoi la communauté queer est si dure avec les queers, ce que je vois, c’est la psychologie et la neurobiologie du traumatisme.
D’éminentes expertes dans le domaine de la neurobiologie, du traitement des traumatismes et de la somatique théorisent que le traumatisme — défini au sens large comme l’exposition au stress ou au danger de mort qui dépasse la capacité de l’organisme à faire face — a un impact profond sur le développement du cerveau et du système nerveux. Les traumatismes répétés, en particulier les traumatismes liés à la violence, aux mauvais traitements et à la négligence, ont un effet particulier sur la façon dont les êtres humains traitent et réagissent aux interactions sociales : en bref, si nous sommes exposé-e-s de façon répétée au danger par le comportement des autres humains, nous en arrivons à considérer tous les humains comme étant dangereux en soi, et tous nos instincts primaires sont formés en considérant les autres humains comme des menaces potentielles.
Appliquons cette théorie aux queers. La recherche sociologique nous indique que les personnes queers et trans sont disproportionnellement susceptibles d’être victimes d’abus, de violence sexuelle, d’être sans domicile fixe et de harcèlement pendant leur enfance et leur adolescence (et cela continue à l’âge adulte pour plusieurs, malgré le projet « It Gets Better » de Dan Savage). Même celleux d’entre nous qui réussissent d’une façon ou d’une autre à échapper à la violence et à la négligence ont grandi dans un monde où nous avions besoin de garder des secrets, où, à tout moment, nous pouvions tomber sur quelqu’un qui nous détesterait ou nous voudrait du mal à cause de ce que nous sommes. Où nos droits fondamentaux et notre dignité pourraient nous être enlevés sur le caprice du prochain politicien qui prendra le pouvoir. Le résultat de toute cette exposition au traumatisme — à la menace très réelle de violence et d’ostracisme de la part de notre famille, de nos amis et de toute la société — est que les queers en tant que groupe social entretiennent elleux-mêmes un grave traumatisme relié à leur perception d’elleux-mêmes et des autres.
Dans son opus à succès de 2014, The Body Keeps the Score, le psychiatre et expert en traumatologie Bessel van der Kolk écrit que la mémoire du traumatisme est codée dans le corps sous forme de sensations intenses et de réactions physiques telles que douleur chronique, engourdissement, respiration difficile, nausées, impulsion du mouvement et autres. Psychologue et inventeur de la résolution somatique des traumatismes, Peter Levine enseigne que ces sensations peuvent être catégorisées comme appartenant à d’anciens mécanismes primaires de survie enracinés dans le système nerveux : fuite, lutte et gel. Ces stratégies primaires façonnent nos émotions, nos pensées et nos croyances fondamentales sur nous-mêmes et sur le monde.
Qu’arrive-t-il à une communauté de personnes qui ont été élevées avec la sensation d’un danger constant et imminent, d’avoir fondamentalement tort dans notre façon d’aimer et de nous exprimer ? Quel impact ce traumatisme collectif pourrait-il avoir sur notre corps et notre esprit ?
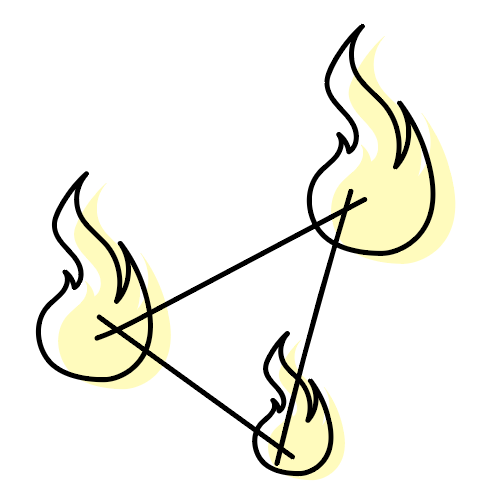
Les spécialistes du cerveau aiment bien dire « ce qui brûle ensemble, se branche ensemble », ce qui fait référence à la tendance du cerveau à former des réseaux neuronaux (voies dans le cerveau qui forment certaines pensées, sentiments et réponses comportementales) qui deviennent de plus en plus forts chaque fois qu’ils sont utilisés. La théorie du traumatisme soutient que les personnes traumatisées — et, selon mon hypothèse, la communauté queer et trans dans son ensemble — ont des réseaux neuronaux bien usés formés autour de la sensation physique profonde que nous sommes constamment en danger, que nous sommes mauvais et peu aimables, que les autres ne sont pas dignes de confiance et violents. Chaque fois que nous sommes victimes de violence, de discrimination ou de négligence, ces réseaux neuronaux deviennent plus forts, tandis que nos réseaux neuronaux associés à la sécurité et aux relations affectives sont atrophiés. Nous devenons physiquement moins capables d’imaginer un monde où être avec les autres n’est pas synonyme d’insécurité.
C’est, je crois, la raison pour laquelle les communautés traumatisées peinent si profondément à s’aimer les unes les autres. Nous avons été muselés par la suspicion et la terreur de la trahison, ce qui, à son tour, alimente les logiques de l’exclusion et de l’emprisonnement : nous en sommes venu-e-s à croire que faire une erreur — toute erreur, grande ou petite — rend les gens mauvais et dangereux. Nous croyons que nous devons punir les gens qui sont mauvais et dangereux, que certaines personnes sont tout simplement trop mauvaises et trop dangereuses pour rester parmi nous.
Quelle ironie — quelle tragédie — que ce soit exactement ce que la société hétéronormative avait l’habitude de croire (et qu’elle continue de croire dans bien des endroits) à notre sujet. Je ne peux m’empêcher de penser que c’est la méthode parfaite pour maintenir une communauté marginalisée et privée de pouvoir : de nous amener à nous détester et, ce faisant, à nous haïr et à nous craindre mutuellement.
C’est la nature du traumatisme relationnel. Elle nous enseigne qu’il y a en soi quelque chose qui ne va pas chez nous, que nous sommes fondamentalement incapables de recevoir de l’amour plutôt que de la violence. Au fur et à mesure que cette croyance s’intériorise dans notre corps et notre esprit, nos anciennes et puissantes stratégies de survie passent au premier plan. Nous devenons extrêmement sensibles à la menace, orientés fortement pour détecter la moindre possibilité de trahison — et nous sommes très sensibles quand il s’agit de ceux qui nous sont proches, ceux que nous aimons et que nous espérons voir nous aimer. Nous sommes prêtes à nous déchaîner et à punir nos amis proches et nos amours lorsqu’ils nous déçoivent, parce que si nous ne le faisons pas, nous risquons d’être punies en premier.
Et c’est pourquoi je crois que les queers peuvent être si agressifs envers les queers : c’est précisément parce que nous voulons tellement nous aimer et être aimées les uns par les autres. Notre traumatisme nous apprend à vivre ce désir d’amour comme irrésistible et explosif à la fois. Pris dans la terreur de cette terrible double contrainte, les anciennes stratégies de survie de notre corps — lutte, fuite, gel — prennent le relais pour nous défendre.
Ce qui est délicat avec les stratégies de survie post-traumatique reliées au corps, c’est qu’elles ont été développées au cours de millions d’années d’évolution. Elles sont destinées à la survie pure et animaliste, et ne sont pas capables de distinguer les nuances sociales ou morales dans le comportement des autres (c’est à cela que sert le cortex préfrontal, la partie antérieure du cerveau, plus récemment développée).
C’est pourquoi les individus et les communautés traumatisés ont été documentés dans la littérature psychologique comme étant plus enclins à la pensée en noir et blanc, un modèle de pensée qui sépare les gens en « tout bon » ou « tout mauvais ». Il s’agit d’un puissant mécanisme de défense lorsqu’il s’agit de situations où nous devons prendre des décisions rapides et affirmées sur qui est bon ou mauvais, ami ou ennemi. Elle est beaucoup moins efficace lorsqu’il s’agit de résoudre des conflits ou de réparer des relations, qui sont bien sûr empreintes d’ambiguïté, de complexité et d’imperfection.
Dans le monde queer, sous la pression constante de l’oppression systémique et de la violence, nos instincts de lutte-fuite-gel sont à bout de souffle. Nous percevons le danger partout, parce qu’il est partout ; et pour compenser, nous exigeons de nos concitoyens une uniformité et une parfaite cohésion. C’est pourquoi nous sommes inondé-e-s d’adrénaline et de cortisol (hormone du stress) lorsque quelqu’un dit ce truc problématique dans cet atelier politique ou lorsque nous voyons notre ami afficher une mauvaise opinion sur Twitter. Nos systèmes de gestion des menaces sont en marche, catégorisant les comportements problématiques comme une menace et passant souvent à l’offensive pour neutraliser le danger perçu.
Les petites trahisons perçues sont, pour notre corps animal, impossibles à distinguer de toutes les nombreuses trahisons et abus du passé. Nos amis et nos proches qui nous déçoivent deviennent indignes de confiance à nos yeux, dangereux ; nous régressons mentalement vers ces moments de l’enfance où l’on nous a fait sentir impuissants et indignes d’amour. Ça recommence. Encore un nouvel exemple du fait que personne ne peut être digne de confiance. Comment ne pas être furieux ? Comment ne pas s’en prendre à ceux qui nous ont fait du mal, exiger la punition et l’évitement, essayer de se débarrasser de celleux qui nous ont fait du mal ? Nous avons bien appris nos leçons quand nous étions jeunes. La punition est le seul moyen de faire apprendre aux gens. Quand quelqu’un a été trop mauvais, il faut s’en débarrasser pour être en sécurité.
Notre pensée traumatique n’est ni mauvaise ni malsaine. Au contraire, elle est très bonne — elle nous a permis de survivre à l’impensable. Ce que je veux dire ici, ce n’est pas que nous devons nous débarrasser de nos stratégies de survie en cas de traumatisme ou douter de notre propre corps, mais que nous devrions peut-être cesser de penser à notre traumatisme en tant qu’individu et le considérer comme collectif. Pour que nous ne souffrions pas seules dans notre traumatisme, une communauté composée d’une pensée « seule contre le monde », mais plutôt une communauté basée sur « guérir ensemble ».
De plus en plus, les leaders et les thérapeutes orientés vers la justice sociale se tournent vers la somatique comme source de sagesse et de stratégie. La somatique est une école de pensée et de pratiques qui centre le corps, sa sagesse animale et sa connaissance primitive, comme la racine du potentiel humain. Une branche spécifique de la somatique est la somatique génératrice, un mouvement de praticiens de la santé politisés de la côte ouest qui croient que « les pratiques sociales et culturelles deviennent des « formes » ou des visions du monde, des habitudes, des façons de se relier, des actions automatiques et des non-actions ».
Quand j’imagine la « forme » de la communauté queer, j’imagine un cercle de personnes assises les unes à côté des autres, chacune enroulée en boule serrée, la tête sur les genoux. Ielles sont les unes à côté des autres, mais ielles ne sont pas ensemble. Nous avons peur de nous toucher. Nous défendons nos frontières en attaquant et en punissant celleux qui les ont franchies, alors que parfois ce que nous voulons vraiment leur demander, c’est de se rapprocher, de leur demander de nous respecter et de nous aimer avec plus de délicatesse et de compassion.
Le changement commence par la conviction que le changement est possible, lorsque nous invitons notre corps à envisager la possibilité que la connexion est possible. Nous sommes capables de créer une culture qui s’engage à guérir au niveau cellulaire, qui nous encourage à expérimenter en tendant la main, en établissant des contacts tant physiques qu’émotionnels. Le contact amoureux libère de l’ocytocine et d’autres hormones qui détendent notre corps et préparent notre cerveau à la pensée relationnelle, éveillent notre imagination et nous permettent d’envisager des façons nouvelles et meilleures de gérer les conflits. Ce qui brûle ensemble se lie ensemble. Aimer le contact engendre le contact. La compassion et le pardon engendrent la compassion et le pardon.
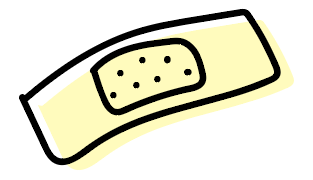
La désescalade signifie que nous devons nous fonder sur notre sécurité intérieure et notre bonne foi générale, pas sur la naïveté de croire que tout le monde est innocent et digne de confiance, mais que chacun-e a le potentiel de l’être. La désescalade consiste à passer en revue les autres options avant de s’engager en mode « combat » complet (bien que nous gardions le mode « combat » à proximité, au cas où nous en aurions vraiment besoin). Cela peut sembler simplement prendre de l’espace dans une relation qui semble devenir toxique plutôt que de répandre des rumeurs sur l’autre personne, de parler en toute humilité plutôt qu’avec colère et indignation devant le comportement problématique d’une personne, de reconnaître son propre ego et sa capacité à faire des erreurs dans la façon dont un conflit peut se traiter.
Concrètement, cela peut signifier s’arrêter et prendre le temps de respirer, de se retenir dans la frénésie des émotions qui surgissent lorsque nous voyons quelqu’un faire des commentaires ignorants ou répugnants en ligne. Nous pouvons faire une pause et demander l’appui des aînés et des pairs lorsque des conflits surgissent (comme ils le font inévitablement) avec nos amis et la famille que nous avons choisie. Nous pourrions passer ce temps à nous occuper de notre moi animal blessé, en nous rappelant que nous sommes entieres, bonnes et aimables. À partir de ce point de repère, nous devenons plus capables de nous connecter, de réparer, de désescalader.
Nous sommes capables de plonger très profondément dans notre corps et notre âme collectifs. Pour insuffler une nouvelle vie à chaque être, pour étendre l’amour même à nos parties les plus craintes et les plus exilées. Pouvez-vous aimer votre propre capacité à faire du mal et à avoir tort ? Puis-je aimer la mienne ? Sommes-nous capables de séparer les frontières entre les comportements nuisibles et abusifs — ce qui est toujours notre droit et une étape nécessaire — et la punition et la vengeance ?
Cela ne veut pas dire que nous devrions permettre aux gens de « s’en tirer » avec des comportements nocifs ou forcer les survivantes à rester dans des relations avec des agresseurs. Les limites sont une partie nécessaire de l’amour. Fixer des limites est une façon de créer des espaces pour s’aimer nous-mêmes et pour aimer les autres en même temps. Il y a une différence entre fixer une limite et contenir des actions nuisibles, même des actions aussi nuisibles que les abus et la violence, et punir quelqu’un pour le plaisir de se venger. Il y a une différence entre mettre fin à une relation avec une personne violente et exiger que la personne violente « disparaisse » de la société.
Dans mon premier cours de somatique, le professeur nous a parlé de la corégulation : la capacité du système nerveux de nos corps à s’accorder progressivement les uns aux autres. Elle a comparé cela à un groupe de lucioles se rassemblant dans la nuit : leur bioluminescence clignotante commence de façon aléatoire et asynchrone, mais plus ils passent de temps ensemble, plus leurs lueurs s’unissent sur un même rythme.
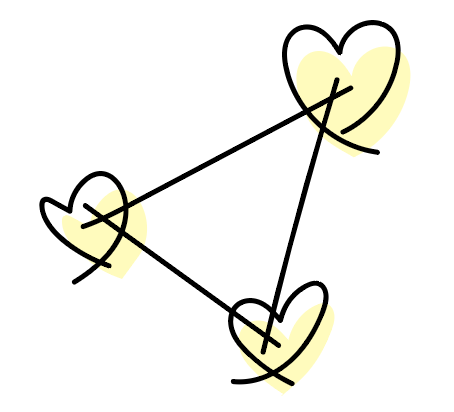
C’est nous : nous sommes tous si puissantes, si brillantes, si capables d’une résilience individuelle et féroce. Nous sommes aussi capables d’harmonie, de nous unir pour former une seule lumière vive. Nous avons la capacité de nous aimer les unes les autres, profondément et en toute sécurité. Et nous sommes capables d’imaginer un monde, de créer un monde où nous n’avons pas à nous entretuer pour survivre.